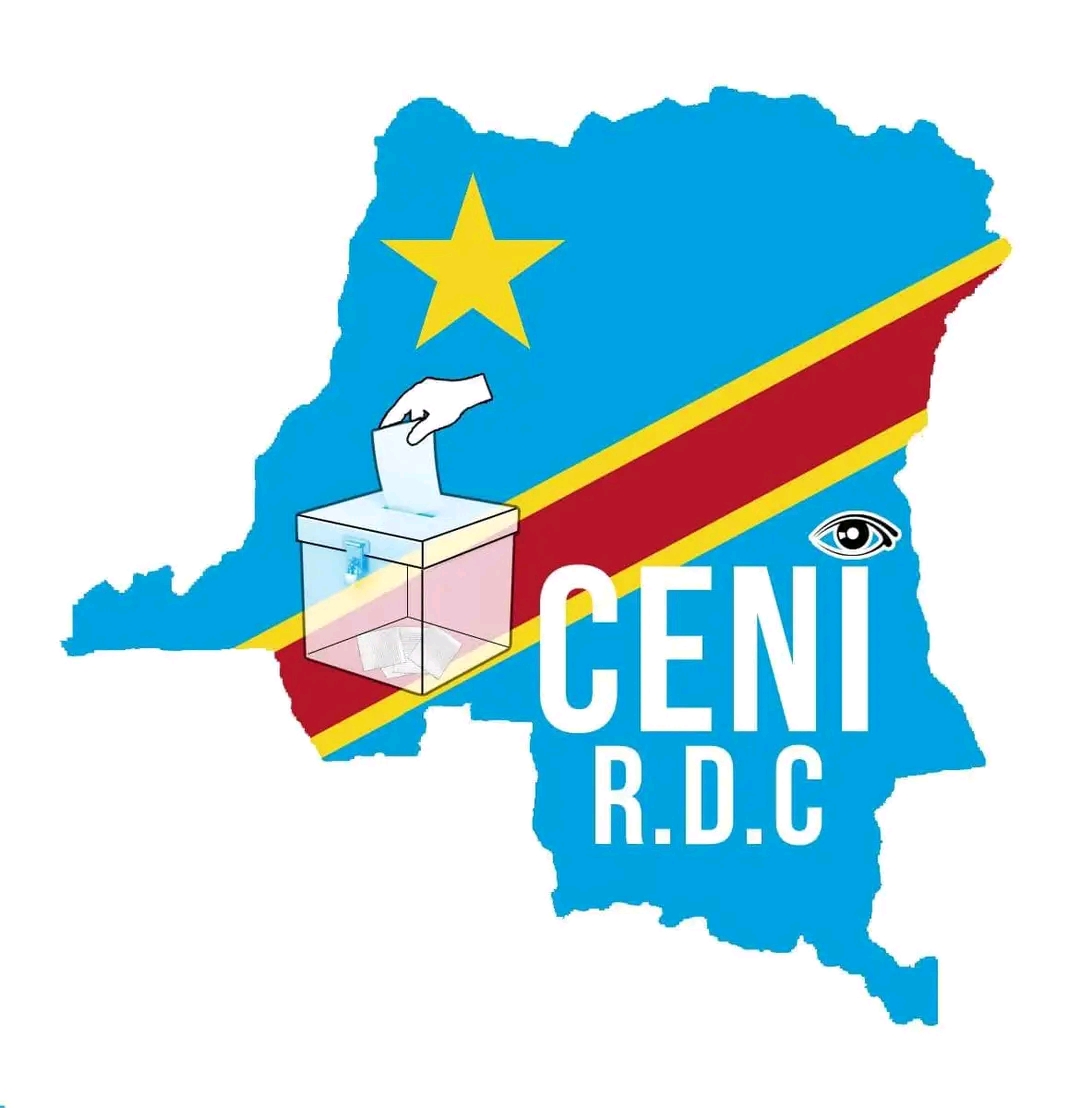La RDC est, selon sa Constitution, un État laïc, assurant la liberté de conscience et de religion à tous ses citoyens. Pourtant, la réalité politique et sociale montre une interpénétration croissante entre la sphère religieuse et les affaires publiques, une situation qui alarme de nombreux observateurs, à commencer par Charles Kabuya, avocat et essayiste.
Dans une déclaration récente sur son compte x, il souligne que « le mélange des genres entre la religion et les affaires publiques, ainsi que les interférences des dignitaires religieux dans l’espace politique, heurtent l’esprit de la Constitution et constituent une menace pour la solidité des institutions de la République ». Cette déclaration dissipes les zones dans l’interprétation de plusieurs versets bibliques et plonge ainsi le scientifique à se poser plusieurs questions d’ordre pratique sur la confusion née de ce constat or malheureux, or, la constitution congolaise est cline.
Une Constitution claire sur la laïcité
La Constitution congolaise place toutes les confessions religieuses sur un pied d’égalité et interdit toute discrimination basée sur la religion. Cette disposition garantit une neutralité stricte de l’État dans les questions religieuses et cherche à protéger les institutions de l’influence excessive des organisations religieuses. Cependant, la pratique montre une érosion de ces principes.
L’engagement politique de certains leaders religieux, souvent sous la forme de conseils, d’injonctions ou de critiques à l’encontre des décideurs publics, est devenu une constante. À cela s’ajoute l’influence subtile mais réelle qu’ils exercent sur leurs fidèles, notamment au moment des élections. Ce phénomène pose une question fondamentale : la gestion des affaires publiques peut-elle être guidée par des intérêts religieux sans compromettre l’unité nationale et l’égalité citoyenne ?
Des risques pour les institutions
Charles Kabuya met en garde contre l’affaiblissement des institutions républicaines par l’ingérence religieuse. « Seul l’intérêt de l’État et de la nation doit présider à la gestion de la République », affirme-t-il, rappelant que les institutions doivent rester libres de toute pression externe. Lorsque des dignitaires religieux influencent directement ou indirectement les décisions de ceux qui gouvernent, cela compromet non seulement la neutralité de l’État, mais également la confiance des citoyens dans l’impartialité des pouvoirs publics.
L’histoire récente de la RDC regorge d’exemples illustrant cette tendance : des figures religieuses appelant à voter pour certains candidats, des coalitions politiques se réclamant de valeurs spirituelles, voire des controverses publiques sur des événements nationaux perçus sous un prisme religieux.
La laïcité comme rempart d’unité nationale
La RDC, avec sa diversité religieuse, ne peut se permettre une politique dominée par des agendas confessionnels. La laïcité est essentielle pour maintenir l’égalité entre citoyens et assurer que les décisions prises par les institutions répondent à l’intérêt général et non à celui d’une confession ou d’une communauté particulière.
Quelles solutions pour un État vraiment laïc ?
- Renforcer l’éducation à la laïcité : Les institutions éducatives doivent inculquer des valeurs d’égalité et de tolérance, tout en expliquant le rôle central de la laïcité dans la construction de l’État.
- Réguler les discours religieux : Il est crucial que les institutions publiques et les autorités religieuses s’engagent à maintenir une distance claire entre les discours religieux et les décisions politiques.
- Promouvoir une gouvernance inclusive : Les dirigeants doivent veiller à ce que leurs politiques reflètent les intérêts de l’ensemble des citoyens, indépendamment de leurs affiliations religieuses.
- Rappeler les devoirs des dignitaires religieux : Les leaders religieux doivent être encouragés à se concentrer sur leurs missions spirituelles et communautaires, tout en évitant d’exercer une influence sur la gestion de l’État.
Un équilibre à construire
La laïcité n’est pas une hostilité envers la religion, mais une garantie que l’État sert tous les citoyens également. En rappelant ces principes, Charles Kabuya pose une question cruciale : quelle RDC voulons-nous construire ? La réponse, pour lui comme pour d’autres penseurs, passe par une stricte application des principes constitutionnels, afin de protéger la neutralité de l’État et d’assurer une gouvernance au service de tous.
Dans un contexte mondial où les tensions entre religion et politique restent vives, la RDC a l’occasion de montrer l’exemple en renforçant les bases de son État laïc. Ce faisant, elle évitera les divisions inutiles et consolidera son chemin vers une unité nationale durable.
MEFLO